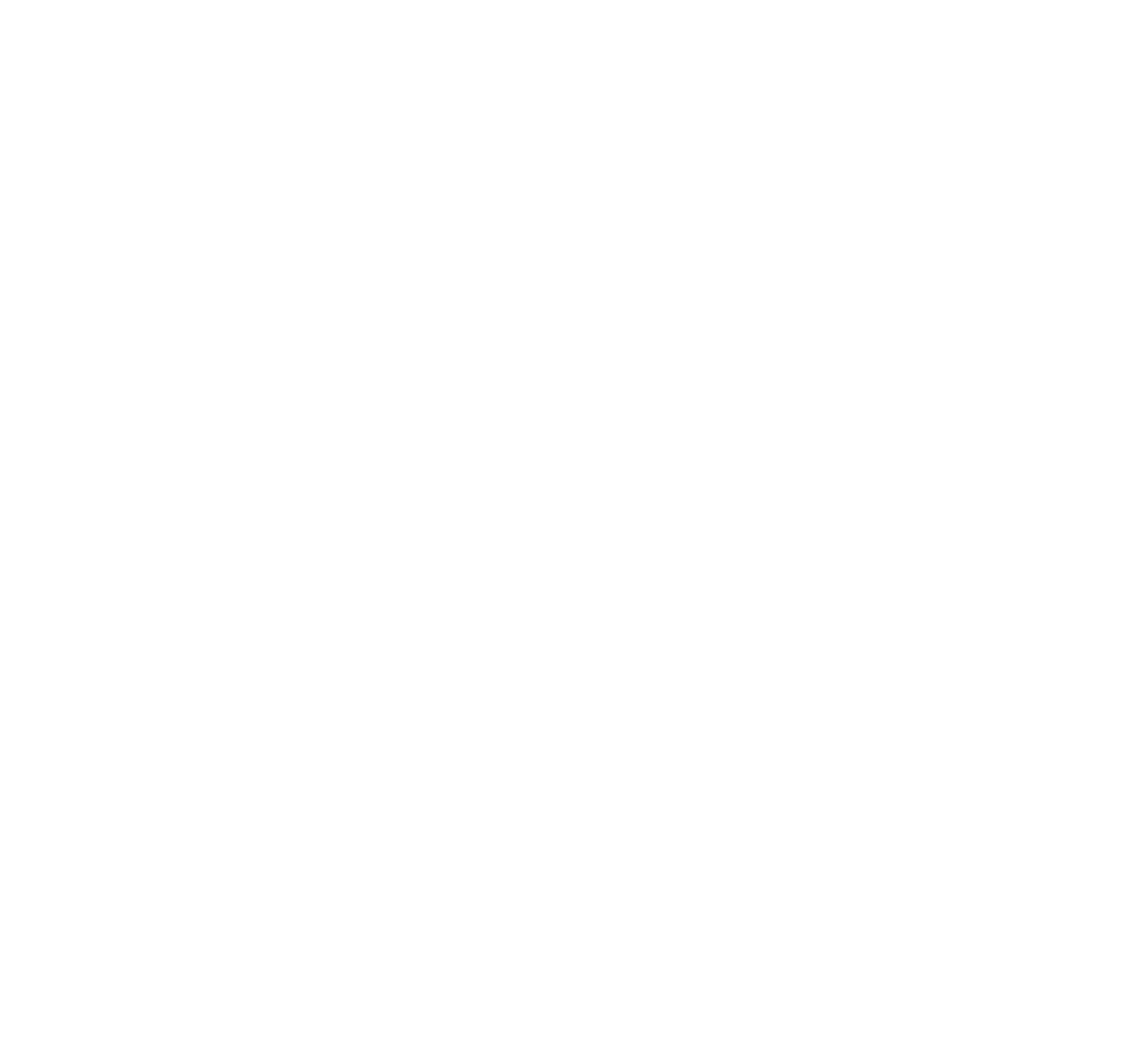Est enfin parue la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral. Ces collectivités ont désormais de nouvelles obligations.
L’agence NOMADE fait le point.
126 COMMUNES CONCERNÉES
Le recul du trait de côte, ou érosion du littoral, est devenu une des principales préoccupations des collectivités locales situées sur le littoral. Phénomène naturel à l’origine, il est accentué par le réchauffement climatique et ses conséquences (hausse du niveau des mers, accroissement des tempêtes, …).
Quelques chiffres : depuis 50 ans, environ 30 km² de terres ont disparu en France à la suite du recul du trait de côte, et 20 000 km de littoral français, dont la Côte basque, sont concernés par cette problématique qui touche aussi bien les espaces naturels qu’urbanisés.
Dans ce contexte, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 contient plusieurs dispositions dans le domaine de l’adaptation de l’urbanisme côtier aux effets du changement climatique.
C’est ainsi que le nouvel article L. 321-15 du code de l’environnement issu de cette loi dispose :
” Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. (…).“
Ce décret établissant la liste des communes concernées a enfin été publié (Décret n°2022-750 du 29 avril 2022, publié au Journal officiel du 30 avril 2022). Cette liste, qui est révisée au moins tous les neuf ans, peut inclure aussi de nouvelles communes souhaitant adapter sans tarder leurs actions. A ce jour, 126 communes ont été identifiées. Mais, à priori, il est fort probable qu’il y ait une liste complémentaire lorsque de nouveaux conseils municipaux auront délibéré.
La plupart des régions côtières sont concernées. La Bretagne est la plus touchée (avec 41 communes inscrites). Les autres régions inscrites dans la liste sont les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse. L’Outre-Mer y figure également avec 25 communes. La Martinique totalise par exemple 13 communes.
En particulier, ont été désignées pour les Pyrénées-Atlantiques les communes suivantes : Anglet, Biarritz, Bidart, Ciboure, Guéthary et Saint-Jean-de-Luz. Et pour les Landes : Mimizan, Capbreton, Soorts-Hossegor, Ondres, Seignosse, Vielle-Saint-Girons, Biscarosse.
Ces communes ont été identifiées en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte. La vulnérabilité des territoires a été déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale. Cet indicateur national de l’érosion côtière, produit par le Cerema (établissement public qui accompagne l’État et les collectivités territoriales sur les politiques publiques d’aménagement et de transport), a permis de déterminer que près de 20% du trait de côte naturel est en recul.

IMPACT DE CE CLASSEMENT
Les communes incluses dans la liste, dont le territoire n’est pas encore couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques (“PPR”) littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, devront, dans un délai de quatre ans, établir “une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte” (nouvel article L.121-22-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi Climat et Résilience de 2021).
La loi prévoit que celles des communes, dont le territoire est couvert par un PPR incluant l’érosion, “peuvent” établir cette carte.
Cette carte devra faire apparaître deux zonages :
- la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans,
- et celle à un horizon compris entre 30 et 100 ans.

DE NOUVELLES RÈGLES DE CONSTRUCTION
La cartographie précitée aura une portée juridique puisqu’elle devra être reprise dans le zonage du plan local d’urbanisme (PLU). La procédure de révision ou modification du PLU devra être engagée dans le délai d’un an après la publication de la liste des communes (nouvel article L.121-22-3 du code de l’urbanisme, issu de la loi Climat et Résilience de 2021).
Un régime d’inconstructibilité progressive est également introduit (nouveaux articles L.121-22-4 et L.121-22-5 du code de l’urbanisme, issus de la loi Climat et Résilience de 2021) :
- dans les espaces urbanisés, vulnérables à l’horizon de 30 ans : il sera interdit de construire, sauf exceptions (travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU délimitant la zone exposée, etc.) ;
- dans les espaces non urbanisés, vulnérables à l’horizon de 30 ans : seules les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la “proximité immédiate” de la mer pourront être autorisées ;
- dans les zones vulnérables à un horizon compris entre 30 et 100 ans : la construction restera possible mais sous condition de la démolition de toute construction nouvelle à la date d’entrée en vigueur du PLU délimitant la zone exposée, et d’une remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais du propriétaire, “lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans“. Il s’agira donc de permis de construire temporaires.
DE NOUVEAUX OUTILS À LA DISPOSITION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
En complément de la loi Climat et Résilience de 2021, une ordonnance du 6 avril 2022, relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, a prévu plusieurs outils à la disposition des collectivités pour anticiper le phénomène d’érosion côtière :
- un nouveau bail réel d’adaptation à l’érosion côtière : ce nouveau type de bail pourra être conclu entre un bailleur public et un preneur sur des bâtiments situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, pour une durée comprise entre 12 et 99 ans, et ce, afin de permettre la poursuite de certaines activités, liées au tourisme ou à l’économie du littoral par exemple ;
- une méthode d’évaluation des biens menacés par l’érosion : l’ordonnance apporte des précisions sur le nouveau droit de préemption à la disposition des communes pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, créé par la loi Climat et résilience de 2021 (nouvel article L.219-1 du code de l’urbanisme). Elle précise notamment que la valeur d’un bien immobilier est en priorité déterminée par comparaison avec des biens de même qualification, situés dans la même zone d’exposition à l’érosion (0 à 30 ans). Et si ces points de repères ne sont pas disponibles, on appliquera une décote à la valeur du bien, proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible, estimée hors zone d’exposition au recul du trait de côte ;
- des dérogations exceptionnelles à la loi Littoral : pour lever certains obstacles liés à ladite loi et pour faciliter la mise en œuvre des opérations de relocalisation des installations et constructions menacées par l’érosion, l’ordonnance autorise des dérogations pour certaines communes. Sont concernées les communes incluses dans le régime spécifique au recul du trait de côte créé par la loi Climat et Résilience de 2021. Elles doivent être engagées dans une démarche de projet partenarial d’aménagement (PPA) : il y a déjà 3 PPA expérimentés sur des territoires pilotes, à savoir Saint-Jean-de-Luz, Lacanau et Gouville-sur -mer. Ces communes vont pouvoir déroger à titre subsidiaire à certaines règles, notamment à l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, lorsque ces règles empêchent une opération de relocalisation de biens ou d’activités menacés dans des espaces plus éloignés du rivage, moins soumis à l’aléa du recul du trait de côte. Ces possibilités de dérogations sont strictement encadrées et limitées pour éviter tout abus.

L’objectif de ces nouvelles mesures est sans aucun doute de modérer la demande des biens les plus vulnérables, situés en première ligne sur le bord de mer, dont on sait qu’il seront soumis à l’érosion côtière à court, moyen ou long terme. Il s’agit donc clairement de faire baisser, par la limitation de la demande, le prix de ces biens afin de faciliter leur acquisition éventuelle par les communes, par le nouvel outil de préemption prévu par la loi climat et Résilience. Mais cet effet ne reste-t-il pas encore hypothétique ? En effet, comme le remarque le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Littoral Aquitain, “l’outil IAL (information des acquéreurs et locataires), déjà en vigueur depuis une quinzaine d’années pour les autres risques naturels, n’a pas montré à ce jour d’effet majeur sur les prix de l’immobilier (en zone inondable par exemple)” et “l’attractivité du littoral est très forte et ne cesse d’augmenter”.
source : www.lexbase.fr (la lettre juridique n°883 du 4 novembre 2021 : Urbanisme (nouvelles-mesures-pour-la-prise-en-compte-du-dereglement climatique) / Les Petites Affiches des Pyrénées Atlantiques, Pays Basque, Béarn du 11 mai 2022 /www.vie-publique.fr